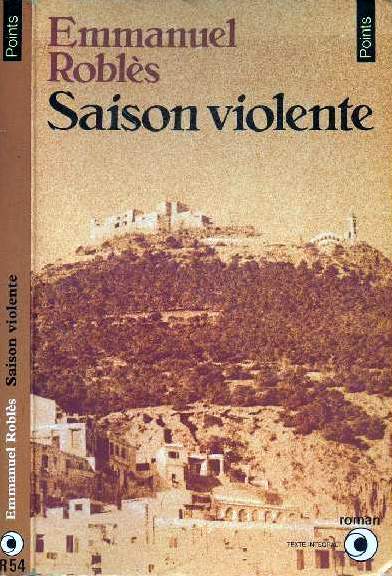
J’ai découvert assez tard les cinquante-pour-cent.
Expression étrange qui permet d’entrer dans une certaine réalité.
Pour moi -et depuis le jour de ma naissance- Oran, c’était des Français et des Algériens. Point.
Le document de René Emsalem sur les villages indigènes m’a permis de commencer à saisir la diversité algérienne à travers les termes très simples de hadar et Berrani.
Je sais maintenant que je dois distinguer entre ceux qui sont là depuis le début de l’Histoire française et qui se trouvent à Ville Nouvelle, ceux qui sont arrivés en cours de route depuis les terres de l’Oranie pour s’installer au sud, du côté de Lamur, et ceux qui arrivent du Maroc et qui remplacent les Espagnols, aux Planteurs.
Je ne maîtrise pas vraiment cette diversité, mais je sais qu’elle existe, et c’est important parce qu’elle permet d’entrer dans la nuance.
Un peu plus tôt, lorsque j’ai commencé à découvrir la diversité européenne, mon regard sur la ville a totalement changé.
Et lorsque ma cousine m’a mis mon arbre généalogique sous les yeux, c’était fini, je sortais de l’innocence : Grec, Italien, Corse, du côté de Paul Souleyre, et Juif d’Algérie du côté de sa femme Meriem pour ce qui concerne les parents de ma grand-mère maternelle. Espagnol de Catalogne pour mon grand-père maternel.
Si je mélange le tout aux ascendants de mon père qui ont mixé les Lorrains de Château-Salins avec les Espagnols de Murcia, on aura un bel échantillon de ce que peut être un Européen d’Oran ou un enfant de pieds-noirs : quelqu’un qui arrive de pas mal d’endroits en Europe, et qui a peut-être mixé cette Europe internationale avec des « Indigènes » juifs, naturalisés en bloc en 1870 par le décret Crémieux.
Et j’ai aussi compris qu’il y avait quelques petits problèmes de communication entre les Français de France, les Français d’Algérie d’origine métropolitaine, les Français d’Algérie d’origine espagnole, italienne, maltaise, corse, grecque, etc. et les Français d’Algérie d’origine juive.
Mon père d’origine lorraine se demandait ce qu’il faisait dans une ville où il n’y avait que des Espagnols. Mon grand-père maternel d’origine espagnole a tout fait pour devenir un instituteur de la République hors pair, et postulait même en 1961 pour le poste de directeur de l’Ecole Normale des Instituteurs d’Oran. Meriem Beroum, de parents juifs et de langue arabe, a tout fait pour s’extraire de sa condition de Juive d’Algérie et se fondre dans la nationalité française. On peut considérer qu’elle a plutôt bien réussi dans son projet, puisque sa fille est devenue institutrice, et sa petite-fille (ma mère) professeur de français.
Notre époque est tout à l’amour de la diversité, mais elle ne sait pas ce que c’est. Et moi non plus. Oran le savait. Et si c’était peut-être la richesse de l’autre -comme on dit de manière pédante et creuse- c’était aussi la violence et la frustration, au sein même de la catégorie des Français d’Algérie.
Emmanuel Roblès lui-même cinquante-pour-cent (dont Edgard Attias a tracé un beau portrait en lien avec Oran, et dont j’avais moi-même parlé précédemment) a mis en mots de façon nuancée ce que pouvait être l’état d’esprit d’un cinquante-pour-cent, ce Français d’origine espagnol, italien, grec, etc. naturalisé à la fin du XIX° siècle.
Dans son roman Saison Violente, le personnage espagnol de la mère est magnifique, laborieux, modeste, délicat. Le père est mort et ce sont les Espagnols des chantiers qui rappellent sa mémoire. Il y a aussi l’Italien, discret, mais bien présent ; une jolie petite Française intelligente mais malade à qui l’on interdit la fréquentation d’un cinquante-pour-cent, un copain arabe et un copain juif (tout en finesse), une magnifique statue de bois cachée dans les profondeurs d’une épave, complètement pourrie de l’intérieur et impossible à sauver malgré des heures de plongée à l’aube, le dimanche matin, à la Cueva del agua ; une Française bourgeoise qui recueille notre petit héros irrécupérable ; un agent de police qui tape sur tout ce qui bouge ; un curé de patronage beaucoup plus intelligent que l’agent de police ; et des manifestations antisémites qui se terminent mal.
Il n’est pas évident de parler de ce livre, mais une chose est sûre, il est intelligent, profond, et évoque de manière fine un monde qu’il connaît bien pour l’avoir vécu. L’histoire est autobiographique.
Je vais en extraire trois passages que j’ai tout particulièrement appréciés :
→ Le premier évoque les cinquante-pour-cent.
→ Le second, Ville Nouvelle et le quartier juif.
→ Et le dernier est un plaisir personnel.
*
Le narrateur a été recueilli depuis plusieurs semaines par Mme Quinson, bourgeoise française parvenue, et se trouve séparé de sa mère suite à leur expulsion d’un patio précaire.
Comme si, en dix semaines, les résultats de ses soins et de son système d’éducation l’avaient profondément déçue, Mme Quinson se mit à me reprocher mon accent, à singer ma manière de prononcer certains mots et elle alla jusqu’à dire : « On aura beau faire, tu es et tu resteras toujours un cinquante-pour-cent. » On nous appelait aussi « caracoles » ou « migas », du nom de nos nourritures de pauvres mais, pour méprisants qu’ils fussent, ces termes m’égratignaient à peine le cuir. Au contraire, « cinquante-pour-cent » m’atteignait au vif tant, à mes yeux, cette expression marquait la volonté de me laisser à la porte, de m’empêcher d’entrer dans le royaume.
Certes, j’avais une conscience très claire de ma double appartenance, toutefois, sur cette rive, l’Espagne n’était qu’un surgeon sans fleurs. Subsistaient des traditions plus ou moins abâtardies, sauf en matière religieuse, mais la langue elle-même se corrompait, contaminée par le français et l’arabe, et l’absence de livres, l’impossibilité d’échanges et même, à un certain degré, l’interdiction à l’école primaire de parler l’espagnol me coupait, au fur et à mesure que j’avançais en âge, de certaines racines.
Ces facteurs, en revanche, me laissaient ouvert, disponible, réceptif ; j’assimilais tout, Louis XIV et Robespierre, Racine et Michelet, la Loire et la Beauce, Molière, Balzac, Hugo ! Le supplice de Jeanne d’Arc me révoltait et les adieux de Fontainebleau m’embuaient les yeux de larmes. Moi, un « cinquante-pour-cent ? » Moi, une moitié d’étranger ? Comment était-ce concevable ? Si je savais ma différence, je connaissais tout aussi bien la profondeur de ma communion. Je n’étais pas à la porte, mais à l’intérieur, non aux frontières, mais sur le territoire même de cette patrie culturelle à laquelle j’adhérais de toute mon intelligence et de toute ma sensibilité.
Cinq ans plus tard je me mettrais à l’étude systématique de la langue, de la littérature et de l’histoire hispanique, poussé dans cette période tourmentée de mon adolescence par le besoin de recouvrer ma complète identité, d’atténuer certaines inhibitions, de construire mon unité intérieure, mais au temps de Mme Quinson je n’éprouvais à ce sujet aucun inconfort : je me sentais Français et je désirais l’être dans toutes mes dimensions. On comprendra mieux, peut-être, qu’en utilisant cette injure Mme Quinson touchait juste et faisait mal !
*
Le quartier juif et celui de Ville Nouvelle (« Village Nègre » à l’époque)
Nouvelle rentrée scolaire. Le narrateur est au lycée Ardaillon dans les années 30. Pour retrouver un peu de liberté, il va de temps en temps faire un tour dans le « Village Nègre », dénomination officielle de Medina Jdida (Ville Nouvelle) à l’époque, puis continue ses déambulations dans le Derb, quartier juif.
L’automne à Oran est la saison claire, plus claire que le printemps, toujours traversée de nuages. La lumière s’accorde alors à l’âpreté des collines et des falaises. Éteints, les vastes incendies de l’été. Le ciel n’est plus qu’une seule dalle d’un bleu laiteux qui, le soir, vire tout entier au vert. En octobre, je repris mes cours au collège Ardaillon. On disait l’EPS, un sigle qui m’a toujours rebuté. Nous avions tous revêtu le pantalon long, coiffé la casquette à visière de cuir et chaussé des souliers. Je parlerai plus loin de mes professeurs mais je veux dire ici combien m’était pénible ce passage de la liberté entière à la discipline des cours.
Pour faciliter cette reconversion et compenser les heures de contrainte, nous flânions longuement après la classe dans le quartier arabe. Aux jours de réjouissance, sur la grand-place de terre battue entourée d’échoppes, de boutiques, de cafés, de bains maures, nous déambulions entre les groupes d’acrobates marocains, de conteurs, de barbiers-arracheurs de dents, de montreurs de singes, de charmeurs de serpents, de marchands d’épices dont les éventaires parfumaient le soleil.
Nous allions, de la même manière, au quartier juif, derrière le théâtre, quartier tout aussi pauvre et tout aussi gai cependant, comme si la pauvreté n’excluait jamais la joie de vivre. Dans la rue principale se tenait un marché permanent d’étoffes, de bonneterie, d’ustensiles de ménage et aussi de fruits et légumes. Ici nous chapardions, et toujours les mêmes produits, des oranges, des dattes, des bananes, des mandarines. Fred, notre meilleur spécialiste, avait une dextérité que nous admirions et qui ne le trahissait jamais. Moins habile le Toni, lui, se faisait parfois « accrocher ». Injures, imprécations, menaces. Cela faisait partie du jeu.
En contrebas de ce quartier, commençaient les rues chaudes mal orientées, sombres, et, à certaines heures, silencieuses. Marco, Fred, le Toni et moi, fringants comme les Mousquetaires, aimions à nous presser devant un huis, à appeler obstinément rien que pour voir s’ouvrir le judas, s’y encadrer le visage de la portière et nous entendre dire avec plus ou moins de bonne humeur d’aller « téter du lait ailleurs » ou autre formule aussi plaisante. Une fois, une seule fois, et parce que les pensionnaires étaient parties en calèche pour la visite médicale, un de ces Cerbères nous permit de pénétrer jusque dans le grand salon. Celui-ci sentait la javel et s’ornait de plantes vertes, de miroirs ; il eut fallu beaucoup d’imagination pour peupler un décor aussi banal de visions enchanteresses.
*
C’est le premier tiers du livre. La mère a essayé de dire au jeune narrateur adolescent (son fils) qu’elle pensait se remarier (le père est mort avant la naissance de l’enfant). Le narrateur lui a fait comprendre qu’il n’apprécierait pas que quelqu’un vienne prendre la place de son père. Dans le passage qui suit, il se remet en question parce que l’expulsion est proche, et que sa mère doit chercher seule et sans ressources, un nouveau logement.
« Hé, si ta mère s’était remariée ! elle aurait eu un compagnon et elle ne serait plus seule à se battre ! »
Le propos m’atteignit durement. Que devais-je en conclure sinon que ma mère s’était plainte de mon attitude et avec des arguments assez forts pour que l’abbé me condamnât ? Et si elle s’était plainte, ce projet de remariage avait donc une réalité ?
Ce jour-là je me rendis sur la falaise, près d’une charmante mosquée, aujourd’hui enclavée entre des immeubles neufs mais, à l’époque, dégagée au milieu d’une étendue déserte, sans un arbre ni un buisson. Il n’y avait même pas encore de parapet et l’espace commençait tout de suite, vertigineux, parcouru d’une lumière ondulante comme un immense fleuve. Aux heures de grand désarroi, j’avais besoin de cette solitude, de ce paysage si vaste où mon cœur se vidait.
*
Quel choc en lisant ce dernier paragraphe. La mosquée ! Telle que je l’avais découverte, isolée au milieu de nulle part, sur une photographie des années 20.

Je ne comprenais pas du tout comment elle pouvait se retrouver aussi isolée dans les années 20 alors que beaucoup d’immeubles étaient déjà construits à Oran.
Mystère.
J’en avais fait une vidéo, dans laquelle je montrais comment le mystère pouvait être résolu. Elle se trouve au bas de cet article.
Je devrais en faire plus souvent.
Paul Souleyre (mais qui est Paul Souleyre ?)
*
C’était il y a un an. Je connaissais mal la ville.
Je cherchais des repères et je me mélangeais les pédales…
*
NB : quelques petites explications.
« Ce jour-là je me rendis sur la falaise, près d’une charmante mosquée, aujourd’hui enclavée entre des immeubles neufs [voir une photo actuelle] mais, à l’époque, dégagée au milieu d’une étendue déserte, sans un arbre ni un buisson. Il n’y avait même pas encore de parapet [le Front de mer est construit bien plus tard, en 1949, et une extension est réalisée en 57] et l’espace commençait tout de suite, vertigineux [ravin de la cressonnière], parcouru d’une lumière ondulante comme un immense fleuve. »



