*
Quand la ville d’Oran refait-elle surface pour la première fois ?
Je dirais au début des années 2000.
Je revois ma mère (malade d’une sclérose en plaques) allongée sur un lit d’hôpital pour une mauvaise pneumonie.
Elle va mieux, mais on s’ennuie à mourir dans la chambre, et je décide de brancher mon Archos JukeBox FM Recorder 20 pour l’inciter à raconter son enfance à Oran. J’ai perdu ces enregistrements. On ne peut pas faire pire comme connerie. Une sorte d’acte manqué ? Je ne sais pas. Peut-être certaines choses doivent-elles restées enfouies.
Je me rappelle que je lui avais demandé de parler de la famille cette fois-ci. Un an ou deux auparavant (donc c’est à ce moment-là qu’Oran fait véritablement retour en moi) je lui avais mis une feuille et un stylo entre les mains avec cette injonction : « Raconte-moi Oran. Pas la famille (sinon tu vas t’énerver) ni la guerre (parce que je peux la lire partout) mais la ville. Comment c’était, là-bas ? »
Le début reste à jamais gravé dans ma mémoire : À Oran, il faisait toujours beau.
Puis la suite : Quand on sortait le matin, habillé de frais, tiré à quatre épingles, l’air était déjà tiède, le ciel grand et bleu, d’un bleu turquoise inimitable, brillant de pureté. Surtout au printemps et en été. Il pleuvait rarement. Quand on est arrivé en France en 1962, je n’avais pas de parapluie, c’est tout juste si je savais ce que c’était. On était imprégné de soleil et de beauté, c’était merveilleux.
C’est le tout début des années 2000.
Pourquoi je demande à ma mère d’écrire sur Oran ? Je n’en ai aucune idée… parce que je n’ai pas le souvenir d’un questionnement particulier à ce sujet. Au contraire, j’ai le sentiment de ne jamais y penser. L’Algérie est à trois millions de kilomètres de mes préoccupations de l’époque. J’ai 30 ans, je vis ma vie, elle est ce qu’elle est, et elle n’a rien à voir avec l’autre côté de la Méditerranée. Pas le moindre questionnement intérieur conscient.
Et pourtant.
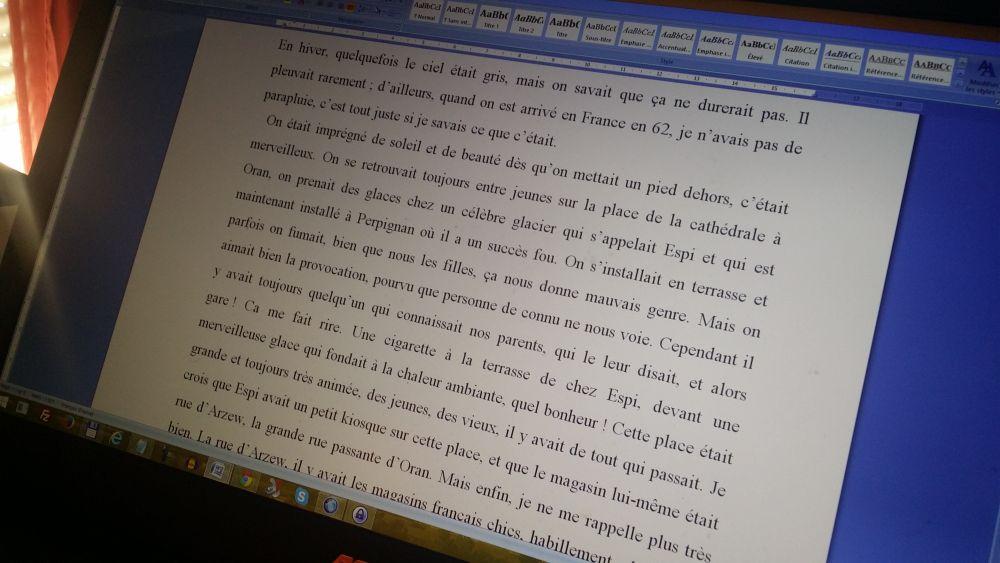
Et pourtant, je demande à ma mère de prendre son stylo et de m’écrire à quoi ressemblait Oran. Sans me parler de la famille et sans me parler de la guerre.
L’injonction est étrange quand on y réfléchit deux secondes. Mais elle veut bien dire ce qu’elle veut dire : ces deux choses-là sont devenus insupportables. Je ne veux plus en entendre parler. Bourrés de mauvaises ondes pour ce qui concerne la famille et bourrés d’idéologie pour ce qui concerne la guerre. Rien à voir avec la réalité, c’est une évidence.
Or je veux essayer de saisir un peu de réel.
Je crois que je ne réécoute pas les enregistrements. Je n’y trouve pas mon compte. Je ne sais pas ce que je cherche à l’époque, mais ce que j’ai enregistré ne me parle pas. De même que les quelques pages écrites n’arrivent pas à me faire entrer dans la vie à Oran. Je suis frustré même si mon questionnement n’est pas tyrannique. Je suis encore capable de vivre sans me poser la question des origines. C’est d’ailleurs la cas de la majorité des gens.
Octobre-Novembre-Décembre 2003, grosse crise d’identité qui sort de je ne sais où, me voilà obligé d’écrire des pages et des pages qui mélangent des tas de choses (philo, cinéma, littérature et… Oran). L’Algérie des mes parents surgit sans que je lui trouve une place appropriée. C’est une tâche au milieu du reste. Je la regarde exister sans arriver à comprendre ce qu’elle fiche là. Je ne lui trouve aucune place, en revanche quelques personnages surgissent : ma grand-mère et Andrée, la sœur aînée de ma mère, décédée jeune, à 11 ans et demi, à Oran.
Comme un petit fantôme qui hante ma mémoire.
« Dimanche, nous revenions de promenade. Il faisait très noir. La lumière de nos phares trouait l’obscurité en un grand éventail. De chaque côté de la route surgissaient des arbres, des bornes, des vagabonds, des cyclistes qui disparaissaient dès que nous les avions dépassés. En face de nous, de temps en temps, jaillissaient les phares éblouissants d’une voiture venant à notre rencontre. Ils semblaient deux gros yeux hostiles qu’une main invisible fermait vite à demi à notre approche. »
Écrire ça à 11 ans, c’est du grand art.
Donc je suis fasciné et j’écris beaucoup. Mais sur autre chose. Et parfois, entre les lignes, quelques réflexions sur ma grand-mère et cette petite, brillante par trois ou quatre textes que j’ai recopiés… et dont j’ai perdu les originaux.
Il faut vraiment se poser la question des actes manqués dans toute recherche. L’inconscient ne veut pas trouver. L’inconscient cherche absolument à protéger l’individu de tout déséquilibre mental -les psychologues diraient de toute décompensation- et ne libère ses secrets qu’au compte-goutte, en s’assurant à chaque instant que l’équilibre psychologique n’est pas rompu.
Il m’autorise à percevoir quelques fragments de mon histoire, mais ne juge pas le moment venu ; je devrai me satisfaire de bribes.
*

*
Deux ans plus tard, septembre 2005, c’est reparti pour un tour, ou plutôt pour un détour.
Je me mets à mi-temps et je décide d’écrire. En revanche, pas d’Algérie, pas de grand-mère, pas de petite fille morte, pas de souvenirs maternels. L’inconscient me fait travailler autour d’une quête identitaire par l’écriture de trois petits romans pour la jeunesse :
1 – Le premier : « Le magicien aux miroirs ».
C’est l’histoire d’un jeune garçon, Pedro, travaillé par l’écriture et qui va être initié à cet art par l’entremise d’un « Magicien aux miroirs » pour le moins étrange. S’il arrive à libérer son écriture, il pourra rejoindre sa chère Sophie. ( = Trouver l’outil de sa recherche, en l’occurrence l’écriture.)
2 – Le second : « La Mésange ».
Un jeune garçon (toujours Pedro, mais sans lien apparent avec le précédent) regarde le monde par l’œil de sa caméra et tombe amoureux (toujours d’une Sophie, mais sans lien apparent avec la précédente). L’initiation l’obligera à se séparer de l’objet technique et protecteur pour enfin prendre le risque de la vie. ( = Partir au contact du monde)
3 – Le dernier : « Vertiges ».
Davantage axé sur une recherche identitaire familiale, on sort de Pedro et Sophie pour découvrir Miro et Sara, une jeune fille qui par son talent de peintre viendra décoincer une situation familiale bloquée. Voyage à travers le passé et l’avenir, ce petit roman embarque le lecteur dans le temps, à la recherche des ancêtres qui emberlificotent leurs descendants dans des filets quasi indémêlables. ( = Sortir des apparences du présent et voyager dans le temps, seule porte véritable de la connaissance).
*
Ensuite silence jusqu’en février 2009, date de la mort de ma mère.
Le verrou de l’inconscient saute. Il n’est plus possible d’endiguer le flot de l’Algérie française. L’exode remonte à la surface, et avec lui, toute l’histoire traumatique familiale.
Mais j’ai 40 ans. Je suis prêt.
Paul Souleyre (mais qui est Paul Souleyre ?)
*
Ma Chère Mémé, Oran, le 22 janvier 1954.
Quand tu recevras cette lettre, je ne serai plus à Oran, et peut-être même que je serai rentrée à l’hôpital de Lyon. Car il faut te dire que je m’en vais mercredi 26 janvier par le « Bréguet 2 ponts » et l’on a accordé le bas de l’avion rien que pour papa et moi. On me fera de l’oxygène pendant le trajet pour que je puisse descendre pendant une escale de deux heures à Marseille. Si tu voyais le joli peignoir que maman m’a acheté ! Il est rose vif et bleu clair et il me va à merveille. On m’a offert un écritoire en cuir dehors et en soie dedans, et c’est la lettre que je t’ai écrite qui a été la première. Je l’ai étrennée pour t’écrire. On m’a offert aussi une trousse de toilette. N’ayant pas eu de réponse à ma lettre, je me suis décidée à t’écrire à nouveau en espérant que tu me répondras. Embrasse tout le monde de ma part ainsi que je t’embrasse bien fort.
Ta petite fille Andrée.
*


